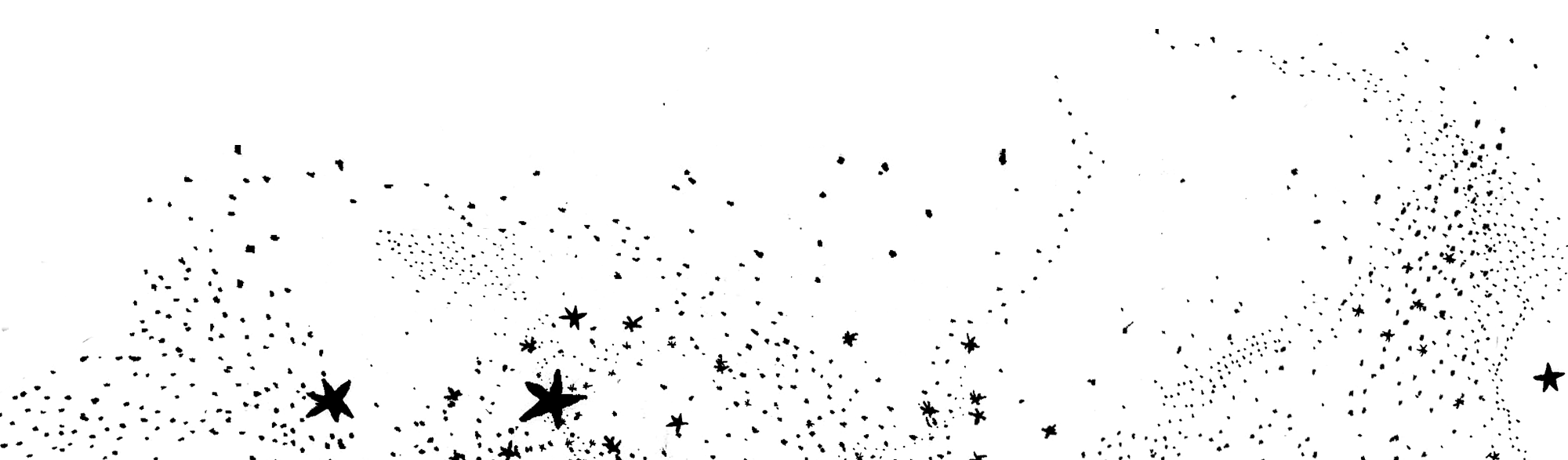Avec «Construire un feu», la Compagnie en déroute livre un lumineux récit initiatique au Théâtre de l’Usine, à Genève.
Le jour commence, un homme traverse le Grand Nord par –50 degrés, seul. Si tout va bien, quand le soleil masqué aura achevé sa course dans le ciel, il aura rejoint le camp, où il trouvera chaleur t nourriture. D’après Jack London, Construire un feu, à voir jusqu’à dimanche au Théâtre de l’Usine dans la mise en scène sobre et évocatrice d’Anne-Cécile Moser, raconte magnifiquement la confrontation d’un homme avec un environnement aussi implacable qu’un dieu grec.
Un cercle de lumière perce l’obscurité du plateau. Le comédien (excellent Jean-Louis Johannides) y pénètre, comme un boxeur sur le ring. Il attaque le récit et entame sa marche, à grandes foulées stylisées. Néophyte dans cet univers sans pitié, l’homme a négligé d’écouter les conseils du vieil Indien qui lui enjoignait de ne pas partir seul et son instinct est défaillant: il est doublement nu face à une nature impitoyable. «Il était un nouveau venu dans la région (…) et c’était son premier hiver. Ce qui lui faisait défaut, c’était l’imagination. Il avait l’esprit vif et avisé quant aux choses de la vie mais seulement aux choses, pas à leur signification », poursuit le comédien. C’est ce manque d’imagination – retrouvée à la toute fin– qui mettra l’homme à la merci de son environnement. Car le froid extrême le met en péril constant: se mouiller les pieds dans un ruisseau peut lui être fatal, sortir à main nue les allumettes de sa poche pour «construire un feu» est un combat interminable quand chaque seconde compte contre l’engourdissement du froid. Dans cet univers sans pitié, une simple erreur menacera son existence. Le chien qui l’accompagne, lui, est guidé par un instinct si lucide qu’il semble proche de l’intelligence. C’est lui qui se «sent déprimé» ou qui «veut du feu». Entre l’homme et l’animal s’instaure
une relation étrange.
Evoquer sans jamais illustrer
La mise en scène d’Anne- Cécile Moser, qui se passe élégamment de réalisme sans renier la violence de l’histoire, donne au récit de Jack London l’envergure d’un questionnement universel. Elle suit en cela l’intention de l’écrivain: s’inspirant des récits des chercheurs d’or du Klondike, l’auteur supprimait de la version de 1908 le nom de l’homme. En lui adjoignant un chien, il questionnait aussi son humanité.
Son écriture dépouillée et vigoureuse résonne avec une netteté de glace dans l’espace épuré de tout décor. Hormis une goutte de glace qui grandit à chaque phrase et pèse d’un poids funeste et lumineux sur le plateau.
DOMINIQUE HARTMANN